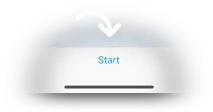Kirill Nazarenko : Comment devenir millionnaire aux Caraïbes ?

Vous lisez un article préparé pendant le développement du jeu de simulation de vie de pirate Corsairs Legacy par le studio Mauris, avec pour objectif de populariser la thématique maritime en général et les jeux de pirates en particulier. Vous pouvez suivre les actualités du projet sur notre site, sur notre chaîne YouTube et sur Telegram.
Dans cet article, Kirill Nazarenko explique comment on pouvait devenir millionnaire dans les Caraïbes.
Bonjour ! Aujourd’hui, je vais vous parler de la façon de devenir millionnaire dans les Caraïbes.
Devenir millionnaire n’a jamais été une tâche facile, et nous savons tous, ne serait-ce qu’à travers la série Black Sails, que la chasse au trésor était une activité très dangereuse. Commençons par regarder comment vivait la population ordinaire, non pas les pirates, et comment on pouvait gagner sa vie sans prendre la mer ni se livrer au brigandage maritime.

La série « Black Sails »
Lorsqu’on parle des Caraïbes, il faut d’abord comprendre comment on y arrivait. Avant même de rêver de fortune ou de plantation, il fallait parcourir une longue route maritime entre l’Europe et l’Amérique. Aujourd’hui, on regarde un horaire de vols, on achète un billet, et en quelques heures on atterrit à l’autre bout du monde. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, il fallait affronter une longue traversée en mer.
Pour vous donner une idée de la durée du voyage vers l’Amérique, prenons l’exemple du trajet retour. En Espagne, on tenait soigneusement les statistiques des voyages de la flotte de l’argent qui revenait des Caraïbes vers la péninsule Ibérique : la traversée la plus courte et la plus rapide vers l’Europe durait environ 40 jours, et la plus longue près de 160 jours, soit plus de cinq mois en mer.
La durée de la traversée dépendait surtout des conditions météorologiques et du vent. Dans une certaine mesure, elle dépendait aussi de l’habileté du capitaine : il pouvait quitter la zone de vents favorables, ou une tempête pouvait chasser le navire hors de ce couloir et celui-ci se retrouvait alors bloqué dans une zone de calme.
De la même façon, doubler le cap Horn était extrêmement difficile. On pouvait le franchir en deux semaines, ou tourner autour pendant un semestre sans y réussir. C’est pourquoi, encore aujourd’hui, les marins modernes se crispent quand les passagers demandent : « Quand arriverons-nous à tel port ? ». Les marins répondent qu’on y arrivera, mais quand exactement, il vaut mieux ne pas le dire trop fort.
Ainsi, pour passer de l’Europe à l’Amérique il y a 300 ans, il fallait passer un temps considérable à bord d’un navire. Pendant toute cette période, il fallait se nourrir, et payer son passage. Et si vous pensez qu’il suffisait de voyager dans une cabine confortable, vous vous trompez très probablement.

La série « Black Sails »
Pour voyager dans une cabine confortable, il fallait être une personne très riche, car les navires de l’époque n’étaient pas spécialisés : il n’y avait ni paquebots de passagers ni cargos au sens moderne du terme, mais des bâtiments polyvalents. Par exemple, sur un navire marchand, si vous étiez très riche, le capitaine pouvait vous céder la seule cabine, située à l’arrière, sur le pont supérieur. Dans ce cas, vous disposiez de 15 à 20 m² d’espace d’environ deux mètres de hauteur.
Bien entendu, un voyageur aussi riche ne voyageait pas seul : plusieurs domestiques l’accompagnaient, ce qui signifie que vous auriez dû partager ces 15–20 m² avec plusieurs personnes. On pouvait tendre des rideaux, séparer un coin chambre d’un coin bureau, et réserver un espace aux domestiques. Vous aviez accès aux latrines de poupe, dans la galerie arrière. Bref, le voyage était relativement confortable. Mais il restait pratiquement impossible de se laver correctement pendant toute la traversée. Les domestiques préparaient la nourriture et, si vous n’aviez pas le mal de mer, vous mangiez relativement bien.
Si vous aviez moins d’argent, il fallait alors se serrer sur le pont principal. Sur un petit navire marchand, vous logeriez dans l’entrepont, au niveau de la ligne de flottaison, où il n’y avait aucun sabord. On vous délimitait un petit coin avec des cloisons où vous passeriez la nuit dans le noir complet, et la journée sur le pont, à l’air libre.
Sur un grand bâtiment, construit comme une frégate ou un vaisseau de ligne, il pouvait y avoir de petites cabines à l’arrière du pont de batterie là où il n’y avait pas de canons. Ces cabines étaient séparées par des parois et vous disposiez d’un sabord, que vous pouviez ouvrir pour admirer la mer (par beau temps). Par mauvais temps, il fallait fermer le sabord, et vous vous retrouviez de nouveau dans l’obscurité.
Si vous aviez très peu d’argent, alors la seule manière de rejoindre l’autre bout du monde, si vous étiez un homme, était de s’engager à bord comme aide contre la nourriture, en effectuant toutes sortes de corvées. En échange, on vous nourrissait et on vous laissait dormir à bord. L’habitude de dormir en couchette commençait tout juste à se répandre, et tous les marins n’y avaient pas droit. On dormait très souvent directement sur le pont, sur un chiffon ou même à même les planches. Et dans ce cas, il était peu probable que vous vous déshabilliez pendant tout le voyage, sans parler de vous laver.
Et si vous étiez une femme ou un enfant, il fallait quand même payer, soit en argent, soit, comme on dit, de son corps. Dans tous les cas, le voyage était une épreuve redoutable.
Il existait une autre manière d’atteindre les Caraïbes : vous pouviez vous engager comme domestique sous contrat, une forme de semi-esclavage. Un riche propriétaire payait votre voyage dans des conditions minimales de confort, après quoi vous deviez travailler pour lui gratuitement, contre nourriture, pendant 3 à 7 ans. C’est ainsi que le célèbre capitaine Henry Morgan est arrivé dans les Caraïbes. Il a travaillé plusieurs années comme apprenti coutelier. Mais là encore, tout dépendait du maître : il pouvait être plus ou moins humain… ou particulièrement cruel. Il fallait d’abord survivre à ces 3–7 années de service.

Le capitaine pirate Henry Morgan
En principe, vous pouviez aussi rejoindre l’Amérique grâce à un mécène, surtout si vous apparteniez à une secte religieuse, par exemple les Quakers. Des Quakers aisés pouvaient sponsoriser le départ de leurs coreligionnaires vers le Nouveau Monde. Mais dans ce cas, vous vous retrouveriez plutôt sur le territoire de l’actuel États-Unis que dans les Caraïbes. On supposait ensuite que vous pratiqueriez l’agriculture au sein d’une communauté quaker.
On pouvait également être déporté en Amérique comme châtiment. Dans « Les aventures du capitaine Blood » de Sabatini, nous l’avons tous lu : le tribunal pouvait remplacer la prison par une vente temporaire en esclavage dans les colonies caribéennes. Mais il s’agissait d’une servitude temporaire. Juridiquement, elle ne durait pas toute la vie, mais un nombre d’années fixé par le jugement. Encore une fois, il fallait survivre assez longtemps pour voir la fin de sa peine.
Vous pouviez également arriver dans les Caraïbes comme commis d’un riche marchand, ou, mieux encore, comme fils de marchand envoyé pour faire du commerce. Ou bien comme personne ayant déjà constitué un capital en Europe et venant l’investir dans l’économie de plantation. Mais ici, nous examinons le cas de figure où l’on veut devenir riche en partant de zéro.
Je me souviens d’une anecdote à propos d’un millionnaire américain du XXe siècle, qui disait être arrivé aux États-Unis avec un dollar en poche. Il a acheté un kilo de pommes sales, les a lavées directement dans l’Hudson, puis les a revendues 2 dollars. Ensuite, il a acheté 2 kilos de pommes, les a lavées et revendues 4 dollars, et ainsi de suite. Le journaliste lui demande : « Et c’est comme ça que vous avez gagné votre premier million ? ». Il répond : « Non, ensuite j’ai reçu un héritage. » C’est pour dire que gagner un million en partant de rien est quasiment impossible. Bien sûr, il existe des exceptions, mais, à mon avis, il est presque plus réaliste de gagner au loto.
Voyons maintenant quelles possibilités nous aurions dans les Caraïbes à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle.
Une fois arrivé dans les Caraïbes, il fallait bien vivre de quelque chose et trouver un travail. Tout dépendait de vos compétences. Si vous étiez artisan formé en Europe, vous pouviez être engagé comme compagnon chez un maître local et, au bout de quelques années, économiser assez pour acheter vos propres outils et ouvrir votre atelier. C’était probablement la voie la plus typique pour quelqu’un qui arrivait dans les Caraïbes avec un métier.
Si vous étiez marin, vous pouviez bien sûr embarquer sur les navires de la région. Un marin expérimenté était le bienvenu aussi bien sur un navire marchand que, le cas échéant, dans un équipage pirate : vos compétences y seraient très utiles.
Si vous aviez un minimum d’instruction, par exemple en navigation, votre carrière était presque assurée. Vous pouviez devenir aide-pilote, puis progressivement monter jusqu’au poste de pilote ou de capitaine. Rappelons que les capitaines de navires marchands, quoique relativement bas dans la hiérarchie sociale, commençaient souvent leur carrière comme simples matelots. Mais s’ils savaient lire et écrire, ils pouvaient recueillir le savoir des pilotes, et apprendre à déterminer la position du navire en observant les étoiles et les planètes.
Il faut rappeler que déterminer sa position en mer était extrêmement difficile. Le chronomètre marin n’a été inventé que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce qui signifie qu’avant cela, il était impossible de connaître avec précision le point où l’on se trouvait entre Londres et, disons, la Barbade. On savait seulement qu’on se trouvait « quelque part entre les deux ». Les chronomètres se sont généralisés dans les marines militaires dans les années 1780, et n’ont pénétré la marine marchande qu’au XIXe siècle : ils coûtaient cher et nécessitaient un entretien constant.

Chronomètre marin
Il était beaucoup plus simple de déterminer la latitude, c’est-à-dire la position entre l’équateur et le pôle, en observant la hauteur maximale du soleil au-dessus de l’horizon et en mesurant l’angle. Avec des instruments assez rudimentaires, on pouvait calculer suffisamment cette latitude et suivre ainsi un cap presque parallèle à l’équateur, qui vous menait vers les Caraïbes ou, au contraire, de retour en Europe. Il ne restait plus qu’à attendre que le veilleur crie « Terre ! ».
Puisque nous parlons de navigation, mentionnons aussi que le baromètre était un instrument rare. Ce n’est qu’à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles qu’il commence à être utilisé en mer. Encore au début du XIXe siècle, les marins capables de lire un baromètre passaient pour des hommes remarquables, car ils savaient prédire le temps. Une chute brusque de la pression indiquait l’arrivée d’une tempête dans la journée, tandis qu’une hausse annonçait la fin prochaine du mauvais temps. L’usage généralisé du baromètre dans la marine marchande date seulement du milieu du XIXe siècle.
Avant cela, les skippers se fiaient à l’intuition et à l’expérience, qui remplaçaient bien des connaissances théoriques. Si vous aviez acquis de l’expérience, que vous saviez lire et écrire, que vous pouviez mesurer la hauteur du soleil avec un instrument simple et lire des cartes marines, vous disposiez de compétences suffisantes pour commander un navire marchand. Et, bien entendu, vous vous seriez très vite extrait du rang des simples matelots.
Dans un équipage pirate, avec de telles compétences, vous pouviez devenir très vite navigateur ou quartier-maître, chargé notamment de la répartition du butin. Si, de plus, vous étiez courageux et physiquement robuste, votre avenir était largement assuré. En revanche, si vous ne saviez ni lire ni écrire et que vous n’aviez aucun métier, les choses se compliquaient fortement.
Sans métier solide, votre corridor d’opportunités était très étroit. Vous pouviez essayer d’entrer comme apprenti chez un artisan, mais si vous aviez déjà une vingtaine d’années, il était difficile d’être accepté, car les apprentis étaient généralement de jeunes garçons, que l’on pouvait bousculer, envoyer faire toutes les corvées, frapper au besoin, comme chez Tchékhov dans l’histoire de Vanka. Un jeune de vingt ans, lui, risquait de rendre les coups, et s’il le faisait, il était aussitôt chassé de l’atelier.
On pouvait aussi travailler comme journalier, mais c’était la base de la base : un travailleur non qualifié avec un salaire très bas. Par exemple, dans la France du XVIIIe siècle, un journalier agricole gagnait environ 4–5 táleros ou piastres par mois.

Tálero
Cela peut sembler une somme non négligeable, car la piastra était une pièce d’argent contenant environ 27,2 g d’argent pur. Avec la ligature, elle pesait environ 30 g. Au cours actuel de l’argent, cela représente à peine 70 centimes de dollar. Si l’on compte environ 0,70 dollar par gramme d’argent, une piastra vaudrait environ 19 dollars. Ce n’est pas énorme. Mais on ne peut pas convertir la valeur d’une piastra uniquement en fonction de l’argent. Il faut se référer à l’or, car le rapport argent/or au XVIIIe siècle n’était pas celui d’aujourd’hui. Actuellement, il est d’environ 1:80, tandis qu’au XVIIIe il tournait autour de 1:15, et au début du XVIe il était même de 1:10.
Ainsi, si l’on convertit la piastra en or, la piastra de la fin du XVIIe siècle correspondrait à environ 2 g d’or, soit environ 110–120 dollars aux cours actuels, une somme tout à fait respectable. Je pense que c’est la méthode la plus correcte pour évaluer le pouvoir d’achat de la piastra. Quoi qu’il en soit, toute conversion de monnaie du XVIIIe siècle en valeurs modernes reste très approximative, car, au XVIIIe, on ne pouvait pas acheter d’ampoules, de smartphones ou de machines à laver : ces objets n’existaient pas.
En revanche, les tissus du XVIIIe siècle étaient très coûteux par rapport au travail investi, mais un vêtement en drap pouvait durer des années. Un habit pouvait servir à son propriétaire 5, 7 voire 10 ans, s’il en prenait soin. On le reprisait, le nettoyait, et même parfois on le retournait : on décousait les coutures, on mettait l’envers à l’endroit et on recousait en déplaçant les boutons. De cette façon, on obtenait littéralement un nouveau vêtement. Aujourd’hui, garder la même veste tous les jours pendant de nombreuses années serait étrange.

Habits et autres vêtements masculins du XVIIIe siècle
Pour mieux comprendre ce que représentait un salaire de 4–5 táleros par mois, réfléchissons au prix du tissu. Un mètre de drap d’environ 1,5 m de large (en unités modernes) coûtait entre 0,7 et 1 piastra si c’était un drap de qualité médiocre pour soldats. Ce qui signifie qu’avec le salaire d’un mois, un journalier pouvait acheter de quoi faire une veste et un pantalon. Mais il devait aussi se loger et se nourrir. Et si le salaire incluait le logement et la nourriture, la paie en espèces était encore plus faible.
Il arrivait aussi que le journalier reçoive des vêtements usagés des propriétaires comme partie de son salaire. Dans tous les cas, il ne pouvait guère se permettre plus d’un vêtement neuf par an. Et si ce vêtement servait tous les jours pour le travail, au bout d’un an il tombait en lambeaux. La nourriture absorbait aussi une bonne partie de ces revenus.
Regardons maintenant le prix de certains produits en Europe, en particulier ceux sur lesquels reposait l’économie coloniale des Caraïbes : sucre, café, colorants, tabac et, dans une moindre mesure, riz.
À Amsterdam, au début du XVIIIe siècle, une piastra permettait d’acheter de 3 à 7 livres de café, soit entre 1 et 2 kg selon la qualité. Le café d’Arabie, importé par les Turcs, était considéré comme le plus prestigieux. Le café des Caraïbes était jugé moindre et donc moins cher. Mais dans les Caraïbes, ces 1–2 kilos de café coûtaient dix fois moins. La clé consistait à planter les caféiers, puis à disposer d’un nombre suffisant d’esclaves pour récolter les fruits.
Les esclaves étaient peu coûteux : un esclave africain dans les Caraïbes valait environ 12 táleros (12 piastres), soit l’équivalent de 12 à 24 kg de café sur le marché d’Amsterdam. Il est clair que les coûts de main-d’œuvre étaient extrêmement bas.
Pour le sucre brut (tel qu’il était exporté des Amériques vers l’Europe), on pouvait acheter environ 8 kg pour un tálero en Europe. En termes de prix d’un esclave, quelque chose comme 100 kg de sucre brut équivalait au prix d’un esclave. Le sucre raffiné coûtait environ 2,5 à 3 fois plus cher.

Esclaves africains travaillant dans les plantations de sucre
Le raffinage du sucre était un procédé complexe. On le filtrait à travers du charbon d’os broyé, ce qui lui donnait une couleur plus claire —jaune pâle ou presque blanche— et le débarrassait de nombreuses impuretés. Mais, en règle générale, le raffinage se faisait déjà en Europe, activité très rentable, tandis que les colonies caribéennes exportaient surtout du sucre brut.
Pour ce qui est du riz, on pouvait acheter environ 15 kg pour un tálero en Europe, et beaucoup plus dans les Caraïbes même.
Pour comparer avec d’autres produits : une bouteille de champagne au XVIIIe siècle coûtait environ 2/3 de piastra. Avec 2 piastres, on pouvait donc acheter trois bouteilles de champagne, un vin très cher. À l’opposé, un singe exotique pouvait coûter environ 25 táleros. Autrement dit, en Europe, un singe se vendait deux fois plus cher qu’un esclave dans les Caraïbes. Voilà une illustration frappante de la logique des prix à l’époque coloniale.
Le fromage parmesan, que Billy aimait tant dans L’Île au trésor, coûtait environ 2/3 de piastra le kilo, soit à peu près le même prix qu’une bouteille de champagne. Seules les personnes aisées pouvaient se permettre champagne et parmesan. Un fromage hollandais ordinaire coûtait trois à quatre fois moins cher.
En ce qui concerne les armes, elles n’étaient pas si coûteuses. Par exemple, une lame d’épée sans poignée ni fourreau coûtait environ un tálero. C’était un produit de qualité moyenne parfaitement utilisable, pas de l’acier de Damas évidemment, mais suffisant pour partir en course ou au pillage. Pour la poignée et le fourreau, il fallait ajouter environ une piastra. Ainsi, une épée prête à l’usage coûtait environ deux piastres en Europe et sans doute 3–4 piastres dans les Caraïbes. Il était donc moins cher d’acheter une épée qu’un esclave, même « bon marché ».
À ce stade, si nous parlons de devenir millionnaire, la question se pose : comment sortir de la condition de journalier ou d’apprenti et accumuler un capital de départ ? Il n’y avait pas de recettes miracles à l’époque (et je ne vous en dévoilerai pas aujourd’hui non plus), mais on pouvait emprunter une certaine somme et se lancer dans le commerce. Restait à savoir qui voudrait prêter de l’argent à un va-nu-pieds.
D’abord, il fallait se procurer des vêtements convenables. Ensuite, il fallait convaincre un marchand ou un propriétaire d’une certaine fortune de vous accorder un crédit. Dans les Caraïbes, les communautés étaient restreintes, et tout le monde se connaissait. Il était très facile de prendre des renseignements sur votre compte. Si les relations de ce riche personnage racontaient que vous étiez un miséreux récemment débarqué d’Europe avec des habits obtenus par ruse ou par hasard, vous n’obtiendriez aucun prêt. De plus, on faisait rarement confiance à la simple promesse orale : il fallait fournir des garanties.
Nous revenons donc à la question : où trouver ce gage de valeur ? À ce stade, il était possible de devenir l’associé d’un négociant qui envoyait des marchandises des Caraïbes vers l’Europe. Si vous aviez de la chance et que ni les tempêtes ni les pirates n’envoyaient votre navire par le fond, vous pouviez, au bout de plusieurs voyages, réunir un capital respectable, affréter un navire pour votre propre compte, continuer à économiser et à réinvestir vos gains, et, à terme, faire construire votre propre petit navire. Pour cela, il valait mieux s’adresser à un chantier anglais ou néerlandais ; au XVIIe siècle, les Provinces-Unies étaient le centre de la construction navale commerciale. On y construisait rapidement et à moindre coût. En Angleterre, c’était plus lent et plus cher. Vous pouviez obtenir un navire à deux mâts, par exemple un brick, et faire du commerce dans les Caraïbes.

Brick à deux mâts
Rappelons que le grand commerce atlantique suivait souvent un schéma triangulaire classique. Un navire quittait l’Europe pour les côtes d’Afrique, où il chargeait des esclaves, en échange de quoi il livrait aux Africains des biens jugés utiles : poudre à canon, mousquets, armes blanches, barres de fer, pas seulement des perles de verre comme on le raconte parfois. Les tribus côtières africaines étaient très bien armées et savaient parfaitement ce que valaient les produits européens. Elles traquaient d’autres Africains à l’intérieur des terres pour les vendre comme esclaves aux Européens.
Ensuite, avec la cale pleine d’esclaves, le navire traversait l’Atlantique vers les Caraïbes, où ces personnes étaient vendues et où l’on achetait du sucre, du café, des colorants, du riz et du tabac pour le voyage de retour vers l’Europe.
Parmi ces produits, le tabac était l’un des plus précieux. Une livre de tabac (la livre variant selon les pays entre 400 et 500 g) pouvait coûter 1 à 1,5 tálero. Dans l’histoire bien connue du « mauresque de Pierre le Grand », on raconte que le tsar dote d’un enfant africain pour une livre de tabac. Si, dans les Caraïbes, un esclave coûtait 12 piastres, et qu’une livre de tabac valait 1–1,5 piastra, l’échange semble réaliste. Pour un enfant encore incapable de travailler et susceptible de mourir avant l’âge adulte, ce prix était plausible. Fumer était un plaisir coûteux, probablement plus cher, proportionnellement, qu’il ne l’est aujourd’hui.
La popularité du tabac tenait aussi au fait qu’il permettait d’exhiber sa richesse : on brûlait littéralement de l’argent. Une livre de bon tabac coûtait autant qu’une lame d’épée ou qu’une bouteille de champagne.
Naturellement, le désir de fumer était fort, mais tout le monde n’en avait pas les moyens. En Europe, on falsifiait donc le tabac en y ajoutant différentes herbes. En Hollande, par exemple, il devint habituel d’ajouter du chanvre aux feuilles de tabac. Ainsi, lorsqu’un Hollandais du XVIIe siècle fumait, il ne consommait pas du tabac pur, mais une sorte de drogue légère. On le voit clairement sur les scènes de genre hollandaises, où les fumeurs apparaissent dans un état d’ivresse avancée.
En Hollande, on avait aussi coutume d’ajouter de l’eau-de-vie à la bière. Fumer du bon tabac pur était donc un luxe. En plus du tabac à fumer, il existait le tabac à priser, une pratique réservée aux milieux nobles et aisés. Le tabac était réduit en poudre, et l’on enprenait une pincée dans le nez, ce qui provoquait l’éternuement. Même des personnages célèbres s’y adonnaient. Par exemple, Catherine II de Russie prenait du tabac à priser. Elle le prenait toujours de la main gauche, afin que la main droite, qu’elle tendait aux courtisans pour être baisée, ne sente pas le tabac. Fait intéressant, fumer était perçu comme une habitude exclusivement masculine. Si une dame fumait, elle le faisait en secret. En revanche, prendre du tabac à priser était toléré.
Si vous et moi réussissions à nous enrichir un peu grâce au commerce, nous pourrions acheter une plantation dans les Caraïbes, acquérir des esclaves (ou les faire venir sur notre navire) et commencer à produire du sucre ou du café, ou à cultiver du riz ou du tabac, voire à produire certains colorants. Ainsi, on pouvait devenir véritablement riche. Mais s’agissant du mot « millionnaire », il est peu probable qu’on puisse réunir un million dans la monnaie de l’époque : un million de piastres était une somme gigantesque.
À titre de comparaison, le budget annuel d’un pays développé comme la Grande-Bretagne ou la France au début du XVIIIe siècle était de l’ordre de 35–40 millions de táleros. Posséder un million de táleros à titre privé était presque inimaginable. En revanche, si vous disposiez de 100 000 piastres, vous étiez déjà considéré comme extrêmement riche.
Se posait alors la question : que faire de cette richesse ? Par exemple, en Grande-Bretagne, on pouvait simplement être un riche marchand, car les frontières de classe y étaient déjà assez poreuses.
En France, si vous amassiez une fortune considérable, vous auriez vraisemblablement dû l’investir dans un titre de noblesse. Il fallait devenir noble, ou, mieux encore, acheter un titre pour légitimer votre statut. Un commerçant simplement riche était tourné en ridicule. Rappelons le Bourgeois gentilhomme de Molière. Seul un noble —et surtout un noble titré— avait le droit d’afficher un luxe ostentatoire.
En Italie, dès le XVIIe siècle, le commerce des titres s’était largement banalisé. Il suffisait d’apporter une certaine somme dans les cercles proches du pape pour obtenir un titre. On pouvait aussi acheter un titre à un noble désargenté. C’était considéré comme une transaction légale.
En France, c’était plus difficile, car l’État était plus centralisé et plus structuré que les États italiens. Il fallait approcher la cour avec des pots-de-vin, mais si vous aviez de l’argent, ce n’était pas insurmontable. Bien entendu, la « vraie » aristocratie savait parfaitement si un titre avait été acheté et que vous n’aviez aucun ancêtre prestigieux. Malgré tout, cela vous permettait de légitimer votre fortune et de mener grand train à Paris ou en province.
En Espagne, la situation était plus compliquée encore, car les opportunités d’affaires y étaient plus limitées et l’ordre mieux établi dans les colonies. On s’enrichit plus vite là où les impôts sont peu ou mal collectés, alors que là où l’État prélève rigoureusement, l’enrichissement rapide est difficile. Il y avait donc moins de fortunes spectaculaires dans les colonies espagnoles. Mais, pour certains, cela restait possible, surtout si l’on disposait d’un capital de départ, sous forme d’argent ou de compétences. Par exemple, l’aptitude à lire et écrire permettait de se faire engager comme commis, puis comme intendant sur une plantation, ce qui constituait déjà un ascenseur social. En revanche, l’analphabétisme et l’absence d’un métier qualifié vous plaçaient au bas de l’échelle sociale.

Servitude en Europe de l’Est
Et pourtant, ce n’était même pas le tout dernier échelon. Encore plus bas se trouvaient les paysans, qui, dans la plupart des pays européens, dépendaient entièrement des nobles et des propriétaires fonciers. Même là où il n’existait pas de servage juridique, la dépendance envers le seigneur était très forte. En Europe de l’Est, le servage légal existait à part entière : non seulement en Russie, mais aussi dans la République des Deux Nations, en Hongrie, dans l’est de l’Allemagne et en Bohême.
Même en France, en Italie ou en Espagne, où le servage formel n’existait pas, la dépendance économique et judiciaire des paysans envers les seigneurs restait considérable. Le pouvoir judiciaire appartenait aux seigneurs, de même que la propriété de la terre. Un paysan français ou espagnol ne pouvait pratiquement pas se rendre dans les Caraïbes : personne ne l’aurait laissé quitter le village où il était né et où il était censé mourir. Il aurait fallu fuir, en rompant ces liens légaux, ce qui rendait l’entreprise encore plus périlleuse.
Bien sûr, il y a toujours eu des aventuriers et des chanceux, et certains d’entre eux ont réussi à bâtir une grande fortune. Mais ces cas restaient extrêmement rares. La grande majorité de ceux qui parvenaient jusqu’aux Caraïbes menaient la vie dure des artisans, journaliers ou marins ordinaires. Dans le meilleur des cas, ils pouvaient devenir contremaîtres dans une plantation. Devenir millionnaire dans les Caraïbes coloniales était possible en théorie… mais très peu probable en pratique.
Nous espérons que cet article vous a été utile !
Pour en savoir plus sur le projet Corsairs Legacy – Historical Pirate RPG Simulator et l’ajouter à votre liste de souhaits, rendez-vous sur la page Steam du jeu.